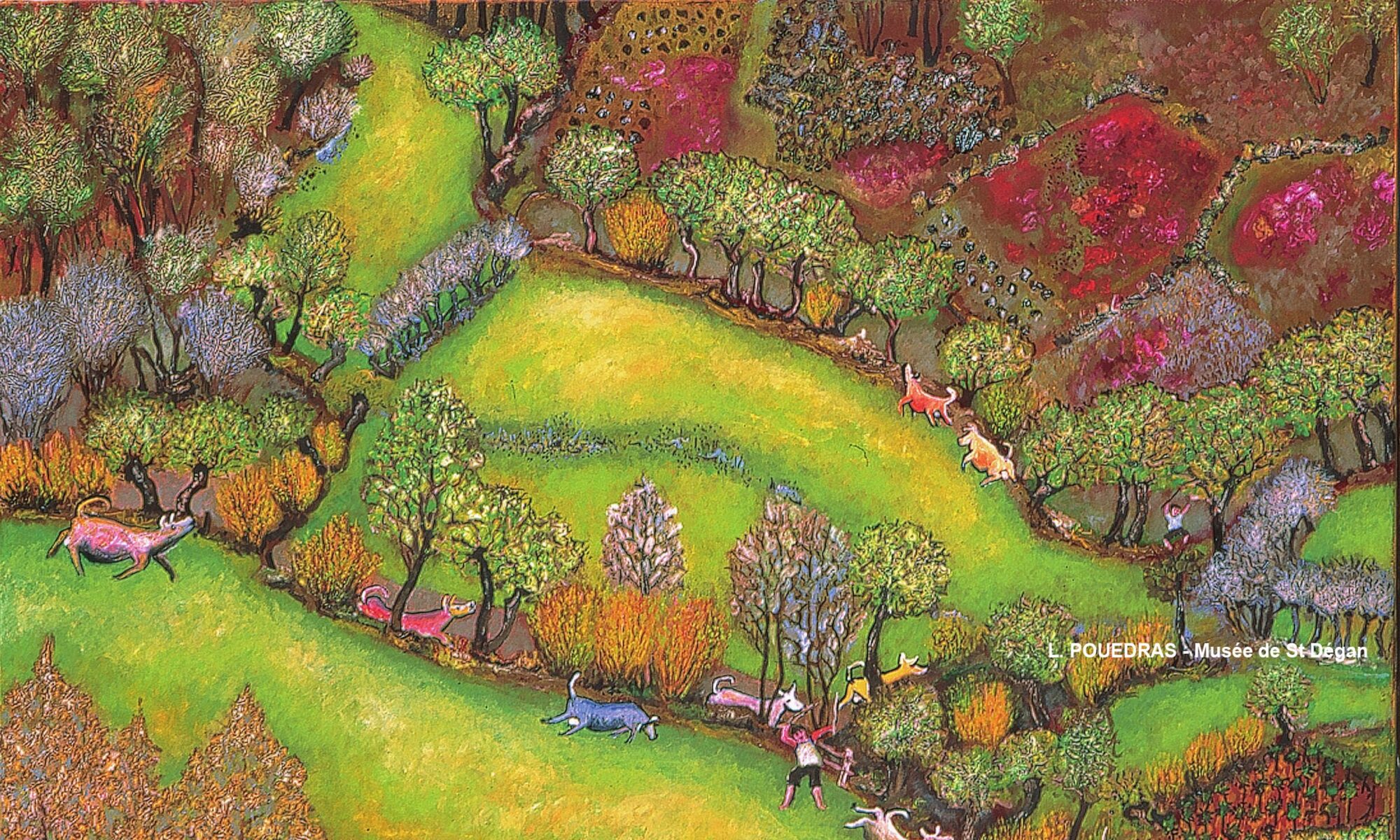La haie sur talus = frein au ruissellement et à l’érosion
La haie sur talus perpendiculaire au sens de la pente constitue une excellente barrière naturelle pour réduire la vitesse d’écoulement de l’eau de ruissellement. En l’absence d’obstacle, le ruissellement issu des parcelles agricoles prend de la vitesse (0,3 à 1m/s), ce qui engendre de l’érosion.
La haie sur talus permet de ralentir les écoulements. Une haie bien positionnée permet de réduire la vitesse de ruissellement à moins de 0,20m/s. En zone de culture, les éléments du sol sont conservés à l’intérieur de la parcelle qui garde ainsi son potentiel agronomique.
En fonction du type de sol et selon l’importance de la pente, sa longueur, certaines parcelles peuvent perdre jusqu’à 80 t de terres par hectare. Il suffit d’une faible pente pour que l’eau prenne de la vitesse et atteigne une force suffisante pour arracher les particules fines de terre. L’érosion a parfois des effets insidieux, peu visibles. Elle peut déplacer toute une masse de terre à l’intérieur d’une même parcelle. Elle peut aussi être beaucoup plus spectaculaire si le ruissellement se concentre dans une ravine.
L’érosion amoindrit la fertilité des terres. Elle “décape, la couche du sol la plus riche, celle qui est en surface.
De nombreux paramètres déterminent l’efficacité d’une haie. Pour être efficace, et avec une véritable action antiérosive, une haie plantée doit présenter 60 cm de dénivelé entre le creux situé à sa base, et son sommet. Pour être planté d’arbres, son sommet doit faire 80 cm de large. La création d’un talus demande de la bonne terre, mais uniquement pour son cœur. Il est donc rarement nécessaire de faire venir de la terre, celle-ci peut être prise sur place à l’endroit du talus. Au moment des réaménagements parcellaires, il est important de penser à bien (re)positionner les talus et les haies. Il est en effet possible de créer ou de déplacer des talus boisés. Cela évite de supprimer, puis de refaire.
Les talus perpendiculaires à la pente et les ceintures de vallées sont les plus importants pour la protection du sol et la qualité de l’eau. A l’échelle de tout bassin versant, une succession de talus ralentit fortement le transfert d’eau et limite l’érosion. Pour les syndicats d’eau, le rôle des talus en bas de versant est fondamental : ils évitent que l’eau et la terre se retrouvent directement dans les rivières.
La ceinture de fond de vallée est l’avant dernier rempart pour la qualité de l’eau, elle sépare souvent des qualités de sol. Pour la lutte contre l’érosion, elle doit retenir prioritairement l’attention.
La haie = Régulateur du flux d’eau =effet tampon
Les talus boisés laissent du temps à l’eau pour s’infiltrer en profondeur.
L’ensemble haie et talus favorise l’infiltration de l’eau dans le sol grâce à l’action de racines et à une meilleure structure du sol au pied des haies. L’ensemble joue un rôle de rétention. Cette capacité de stockage est évaluée sur 40 cm de profondeur, 40 m en amont et sur 1 m de profondeur au sein du talus. Certaines études estiment ce stockage à 5 m³ par mètre de haie. Cet effet tampon permet de stocker l’eau à l’échelle du bassin versant et de limiter l’intensité des crues en aval. Le bocage joue donc un rôle important pour réduire les phénomènes d’érosion et recharger les nappes en profondeur.
La haie = filtre contre les pollutions du sol
La haie est également reconnue pour filtrer les nitrates et dégrader des substances actives par l’action des arbres et arbustes qui la constituent. Plusieurs études réalisées en Bretagne montrent que les teneurs en nitrates chutent brutalement à proximité de la haie. Des analyses de sol effectuées à intervalles réguliers selon un axe perpendiculaire à la haie montrent que les teneurs en nitrates chutent brutalement à proximité de l’axe arboré. Le même schéma d’analyse met en évidence une teneur en azote ammoniaque plus élevée à 5 m de part et d’autre de l’axe de la haie.
La haie est une véritable « barrière » biogéochimique pour l’azote. Deux types de processus interviennent au pied des haies
- L’absorption de l’azote par les arbres et arbustes. Cette absorption contribuera à l’effet barrière d’autant plus que les racines vont en profondeur. Plus la haie est productive de bois, plus l’azote est utilisé par les arbres.
- La dénitrification du sol. La dénitrification est la transformation du nitrate de l’azote importé notamment par les engrais, en forme gazeuse. Les nitrates sont solubles dans l’eau et circulent dans le sol. La haie joue le rôle de ralentisseur. Au pied d’une haie, l’azote se retrouve souvent dans une zone plus humide, riche en élément carboné où la vie bactérienne très active favorise la dénitrification. L’azote minéral est alors transformé en gaz et s’évapore. En conditions anaérobies, des microorganismes utilisent l’oxygène des molécules de nitrate pour respirer. Potentiellement, les haies perpendiculaires à la pente, avec fossé humide et feuilles mortes constituent un milieu favorable au développement du processus.
L’exemple du saule est régulièrement cité pour améliorer les sols ou les eaux polluées. Cette essence est reconnue pour fixer et capter de nombreux éléments et notamment les métaux lourds.
Le phosphore minéral (engrais) non soluble et le phosphore organique (lisier) plus ou moins fixés par les argiles et les matières organiques sont stockés en pied de talus. Où là aussi ils subissent des transformations gazeuses.
Ces phénomènes sont très variables d’une haie à l’autre du fait des conditions pédoclimatiques locales.